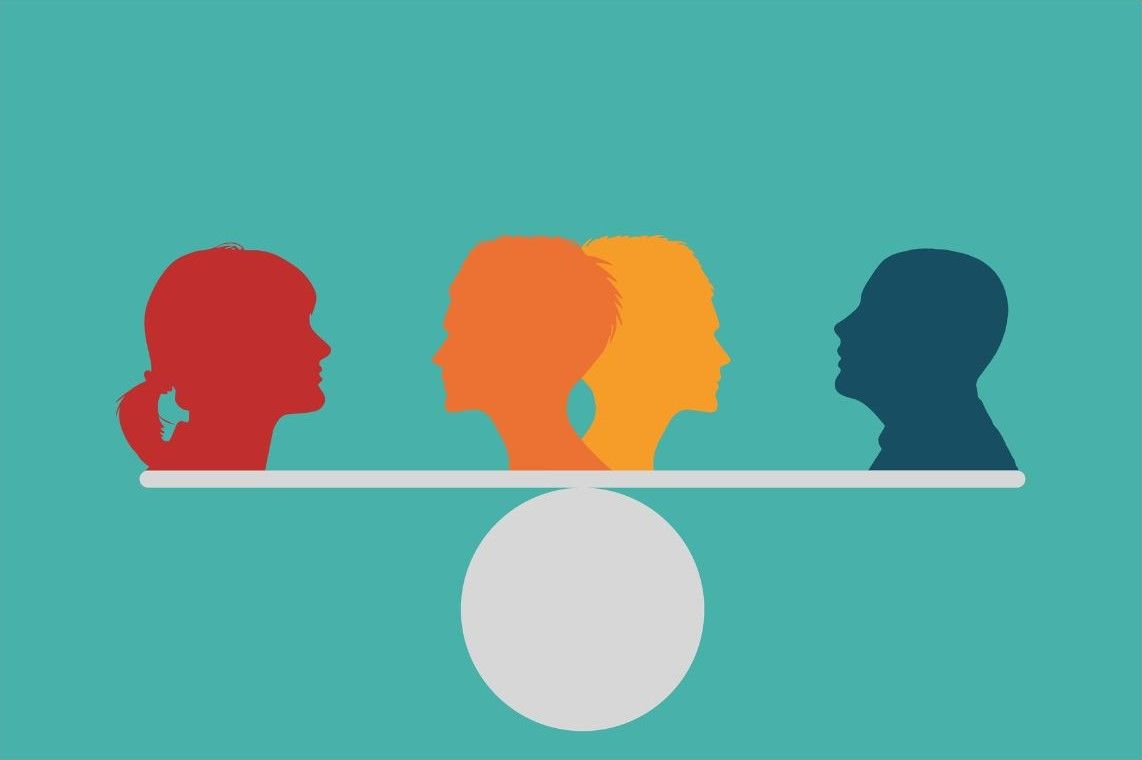Des écarts marqués de sinistralité et d’absentéisme
Entre 2001 et 2019, le nombre global d’accidents du travail a diminué de 11,1 %. Mais cette évolution masque une statistique pour le moins inquiétante : une baisse de 27,2 % pour les hommes et, à l’inverse, une hausse de 41,6 % pour les femmes. Du côté des maladies professionnelles, les femmes sont majoritaires parmi les victimes de troubles musculo-squelettiques, d’épisodes dépressifs ou d’eczémas d’origine allergique, tandis que les hommes restent les plus touchés par les cancers liés au travail.
La Drees a également mis en évidence une progression bien plus forte des arrêts maladie chez les femmes que chez les hommes sur la période 2010-2023. Cet écart ne s’explique pas principalement par la parentalité, mais par des contraintes de travail plus marquées, même si 37 % des différences d’arrêts indemnisés chez les 21-45 ans sont liés aux grossesses.
Des conditions de travail inégalement exposées
Selon l’Insee, la ségrégation professionnelle reste marquée : 23 métiers à prédominance féminine regroupent 41 % des salariés, 44 métiers à prédominance masculine 39 %, et seulement 21 métiers sont véritablement mixtes. Ces répartitions entraînent des expositions différenciées aux risques. Les métiers féminisés de service cumulent en moyenne 7 risques professionnels sur 8, contre 4 sur 8 pour les métiers ouvriers masculinisés.
Les parcours reflètent aussi ces inégalités : 60 % des personnes engagées dans des trajectoires ascendantes continues (où la carrière évolue régulièrement vers des emplois plus stables, plus qualifiés ou mieux rémunérés) sont des hommes, alors que 58 % des parcours descendants (trajectoires marquées par une dégradation des conditions de travail ou de l’emploi au fil du temps) concernent des femmes. De plus, 64 % des salariés occupant des parcours précaires et pénibles sont des femmes, contre 36 % des hommes.
Une méthodologie à mettre en œuvre dans le DUERP
L’article L.4121-3 du Code du travail impose aux employeurs de prendre en compte ces différences dans le DUERP. Pourtant, le rapport sénatorial de 2023 sur la santé des femmes au travail a dénoncé un « défaut durable » de mise en œuvre. Le guide de l’Anact propose donc une démarche en cinq phases : structurer et piloter la démarche, contextualiser l’évaluation, recenser et évaluer les risques avec les unités de travail, formaliser le document unique et, enfin, décliner des actions de prévention adaptées.
L’objectif est de s’assurer que les situations réelles de travail des femmes comme des hommes soient intégrées. Cela passe par des données sexuées sur la sinistralité, des groupes de travail représentatifs et la prise en compte de risques souvent invisibilisés, notamment psychosociaux ou liés à la santé reproductive.
Le guide de l’ANACT : urlr.me/fZdCes